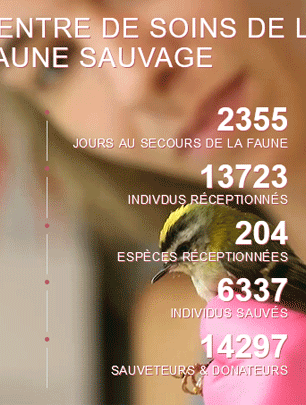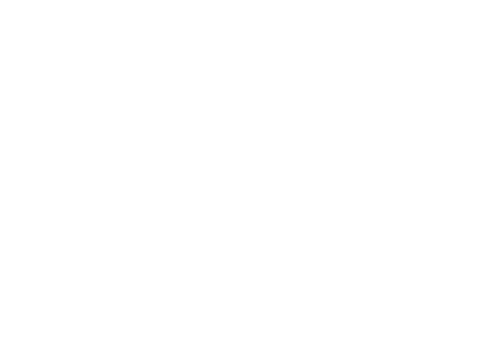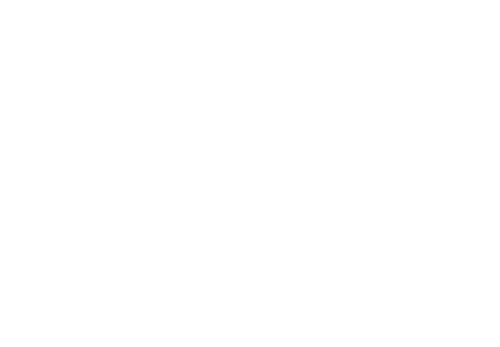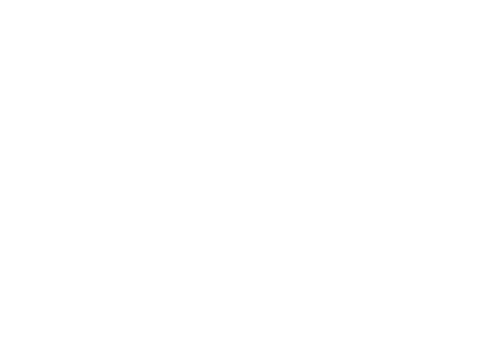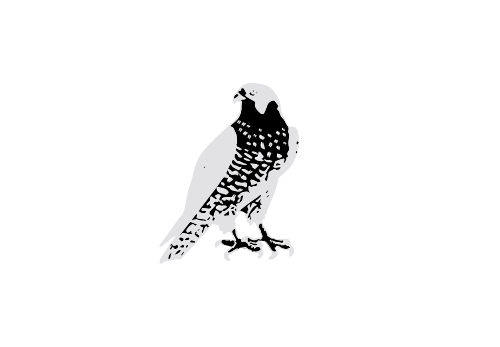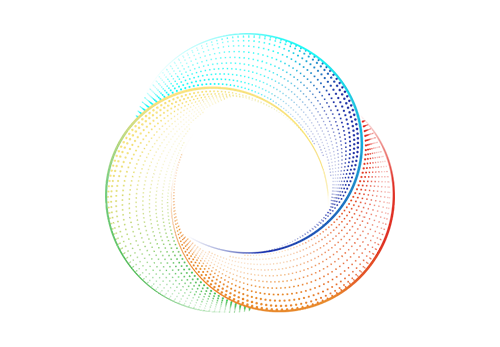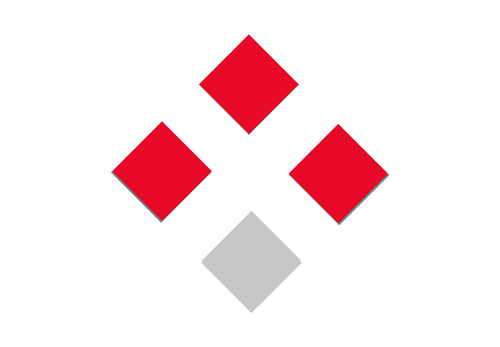Chronique ornithologique
 Points de vue et actualité ornithologique par le biologiste Lionel Maumary.
Points de vue et actualité ornithologique par le biologiste Lionel Maumary.
Une Gélinotte des bois dans les bois du Jorat
Le 31 juillet 2025, alors qu'il promène son chien dans les bois du Jorat, sur la commune de Lausanne, Gilles Duboux a été surpris d'entendre le chant d'une Gélinotte des bois, juste avant qu'elle ne s'envole à 20 m de lui. Il avait déjà cru l'entendre quelques temps plus tôt, mais il n'avait pas pu confirmer cette donnée, tant elle semblait improbable. Ce n'est pas tant l'altitude, d'environ 860 m, qui rend cette observation exceptionnelle, mais son éloignement d'une vingtaine de kilomètres respectivement des sites de nidification du pied du Jura et des Préalpes vaudoises et fribourgeoises.

Gélinotte des bois Tetrastes bonasia, Jura vaudois, octobre 2014. L. Maumary.
En effet la Gélinotte est strictement sédentaire, le mâle encore plus que la femelle, les oiseaux ne se dispersant guère à plus de 1-2 km de leur lieu de naissance. Toutefois, des oiseaux égarés ont été retrouvés en milieu urbain, par exemple en 1921 dans la ville de Bâle, le 23 mars 1948 dans une étable à Bofflens VD, le 4 septembre 1966 à Cudrefin VD, le 27 avril 1967 à Roggwil TG, mi-janvier 1988 à Lonay VD (J. Oberhänsli) ou en 1995 à Zuzgen AG. Il existe en outre plusieurs données de collisions contre des vitres, comme le 23 mars 1984 à Soleure11 ou le 21 mars 2003 à Stans NW (Maumary et al. 2007).
A la fin du XVIIIe siècle, Razoumowsky mentionne que la Gélinotte des bois était présente dans les bois du Jorat au-dessus de Lausanne (Richard 1922). La voir revenir après plus de deux siècles d'absence dans le plus grand massif forestier du Plateau est une nouvelle réjouissante, dans le cadre de la création du Parc naturel du Jorat. Même le Lynx boréal et le Loup gris y ont été revus en 2025, qui l'eut cru?
La Gélinotte est distribuée dans la majeure partie du continent eurasiatique, des Pyrénées françaises à travers la Sibérie jusqu'au Japon. La sous-espèce B. b. rupestris habite les massifs montagneux d'Europe centrale et orientale, du sud de la Belgique et de l'est de la France au sud de la Pologne et au nord de la Grèce. La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à l'Oural (Russie), remplacée plus à l'est par B. b. sibirica. Une autre sous-espèce niche du sud-est de la Sibérie à Hokkaido (Japon). Avec 300'000-480'000 couples, la Fennoscandie héberge la plus grande population d'Europe. La Pologne exceptée, la Suisse est le pays le plus important pour l'espèce en Europe centrale avec 7'500-9'000 couples, et figure parmi les 10 pays européens possédant les plus grandes populations.
En Suisse, la Gélinotte se trouve dans les forêts du Jura et des Alpes, principalement entre 1'000 et 1'600 m d'altitude, montant localement jusqu'à plus de 2'000 m. La donnée la plus élevée avec nidification probable date de 1996 à 2'160 m en Engadine GR (B. Badilatti), et la plus haute observation d'une poule avec des jeunes a été effectuée à 2'060 m au Munt Müsella près de Bever GR (G. Klainguti).
Pendant la première moitié du XXe siècle, on trouvait l'espèce en quelques localités du Plateau, en liaison directe avec des secteurs jurassiens ou préalpins densément peuplés. Les nidifications les plus basses ont été découvertes à Egerkingen
SO 600 m (M. Elsenberger) et dans la forêt de Finges VS 540 m (P. Lüps). La distribution de la Gélinotte coïncide souvent avec celle du Grand Tétras, sauf en Valais et au Tessin où ce dernier fait défaut.
Des variations d'effectifs sous forme chiffrée ne sont pas disponibles pour la Gélinotte, leur obtention étant très difficile de par la discrétion extrême de l'espèce. La contraction de l'aire de nidification est cependant bien documentée dans plusieurs régions de Suisse, notamment dans le nord du Jura6 et la Suisse orientale.
L'espèce était connue en 1919 au Längenberg SH près de Schaffhouse et 1932 au Lägeren ZH/AG (W. Zeller), alors qu'elle ne se trouve plus dans le Jura qu'à l'ouest d'Olten SO aujourd'hui. Au tournant des XIXe et XXe siècles, la Gélinotte était encore fréquente au Pfänder A, où il a fallu attendre jusqu'au 19 janvier 1997 pour une nouvelle observation d'une poule à Eichenberg A (A. Puchta). Jusque vers 1920, on trouvait la Gélinotte sur le Bodanrück D occidental (N. v. Bodman) et au Stammerberg ZH/SH près de Stein am Rhein SH, où la dernière observation date du 1er juillet 1934 (E. Brunner).
Bien que la comparaison entre l'atlas de 1972-76 et celui de 1993-96 montre une situation globalement stable (66 carrés abandonnés contre 60 carrés nouvellement occupés), on peut admettre un recul pendant cette période car l'espèce était probablement déjà présente dans les carrés où sa présence a été récemment détectée. Les observations faites au hasard se font en outre plus rares.
L'espèce habite les grandes forêts de conifères ou mixtes très étagées, pourvues de strates buissonneuses et herbacées offrant un couvert indispensable. Certains massifs purs de feuillus sont également fréquentés, notamment des prairies et pâturages abandonnés et embroussaillés au Tessin. Le biotope idéal est une mosaïque de différentes structures et d'essences végétales variées. Les lisières et les zones de transition de la forêt avec une clairière, un couloir d'avalanche, un sentier, une coupe forestière ou un pâturage sont particulièrement recherchées. Les bois tendres lui sont vitaux car ils lui offrent bourgeons, chatons et pousses comme unique subsistance lorsque la neige recouvre le sol. La Gélinotte affectionne les sous-bois riches en noisetier Corylus avellana, hêtre Fagus sylvatica, aulnes Alnus sp., bouleaux Betula sp., sorbier et alisier Sorbus sp., framboisier Rubus idaeus, ronces Rubus sp., cornouiller sanguin Cornus sanguinea, aubépines Crataegus sp. ou épine noire Prunus spinosa; les myrtilles Vaccinium myrtillus et autres arbustes constituent également une importante source de nourriture à la fin de l'été et en automne. Elle se tient aussi bien au sol que sur les branches, les peignes cornés de ses doigts lui permettant d'avoir une meilleure portance sur la neige et d'atteindre les rameaux les plus fins pour se nourrir. L'ingestion d'invertébrés tels qu'insectes (coléoptères, lépidoptères, diptères, hyménoptères), araignées et gastéropodes joue un rôle important chez les jeunes pendant la phase de croissance. Diurne et très casanière, la Gélinotte vit toute l'année seule ou en couple dans son domaine, d'une taille de l'ordre de 10 ha. Par grand froid, elle peut se laisser ensevelir sous la neige ou y creuser un gîte pour y passer la nuit, voire la journée entière. Le coq se manifeste en automne et au printemps par son sifflement suraigu, à peine audible, ressemblant à celui d'un roitelet ou d'un grimpereau: «tsiih-tihtittittitttituih». Pour défendre son territoire, il se signale également par des battements d'ailes bruyants, audibles à une centaine de mètres, soit en exécutant sur place un bond d'un mètre ou plus, soit en restant à terre, le corps dressé.
La parade nuptiale a lieu de septembre à novembre et de mi-mars à début juin : en présence d'une femelle, le mâle marche lentement vers elle, la queue en roue, dressant la huppe et bombant la poitrine. Le nid est une cuvette peu profonde à même le sol, plus ou moins garnie de végétaux, généralement recouverte par la végétation herbacée, sous les racines d'un arbre tombé, au pied d'un buisson ou d'un jeune épicéa Picea abies mais parfois aussi en terrain découvert. La ponte des 7-11 (3-14) oeufs a lieu dans la seconde moitié d'avril ou en mai, parfois en juin; la ponte la plus précoce débutait déjà le 7 avril 1952 à Erstfeld UR (H. Link) et la couvée la plus tardive a été constatée fin juin 1921 à Hauterive NE (A. Richard). L'incubation par la femelle dure 22-25 jours. L'élevage des jeunes incombe à la femelle surtout. Les poussins sont capables de voler à 14-15 jours et se branchent pour passer la nuit. La famille se dissout plus rapidement que chez les autres tétraonidés, les jeunes à la recherche d'un territoire pouvant occasionnellement faire irruption loin du lieu de naissance entre août et octobre. Il n'y a qu'une couvée annuelle, mais des pontes de remplacement sont possibles en cas de perte des oeufs ou de jeunes poussins. Les densités varient, en fonction de l'habitat utilisable, entre 2 et 5 couples/km2.
Bien que cette espèce soit extrêmement discrète et difficile à recenser, sa régression au cours du XXe siècle est patente, notamment à partir de 1965 dans le centre et le sud de l'Europe. Cette tendance s'est traduite par un retrait des stations les plus occidentales, surtout dans les Ardennes, les Vosges F, la Forêt Noire D et la Pfälzerwald D. Entre 1970 et 1980 en Europe, un déclin de 20-50% a été constaté dans 16 pays; en Allemagne, en Lettonie et en Hongrie, des reculs de plus de 50% ont été enregistrés. Les causes majeures du retrait de la Gélinotte sont à rechercher dans la pénurie d'étendues forestières à strate arbustive et buissonneuse diversifiée, additionnée dans d'autres pays à une pression de chasse trop intense. Les forêts à vocation économique, dépourvues de strate arbustive et pauvres en espèces, de même que les peuplements denses et homogènes dépourvus de clairières ne lui conviennent pas. Cependant, l'évolution récente de la sylviculture, laissant plus de place aux feuillus, avec de grandes surfaces de rajeunissement et une importante strate buissonnante, dans certains cas pour tenir compte des besoins vitaux du Grand Tétras, est favorable à la Gélinotte. Pendant la période de reproduction, les travaux forestiers devraient être réduits au minimum dans les forêts habitées par l'espèce. Quoique la Gélinotte soit moins sensible aux dérangements que le Grand Tétras, les stations situées au-dessous de 800 m ont pourtant été abandonnées pour la plupart, probablement en partie en raison du réchauffement climatique. L'espèce est protégée en Suisse depuis 1962.
Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse et Nos Oiseaux, Sempach et Montmollin.
Richard, A. (1922) : Nidification du coq de Bruyère. Nos Oiseaux 5: 113–117.
 Oiseaux.ch
Oiseaux.ch